Voir la table des matières Ne plus voir la table des matières
- Les cryptos de paiement comme alternative aux devises
- Les cryptos utilitaires pour soutenir l’infrastructure blockchain
- Les stablecoins à l’interface entre crypto et monnaie fiat
- Les cryptos de gouvernance comme outil de décision collective
- Les memecoins comme phénomènes communautaires
- Les tokens de sécurité comme version numérique des titres financiers
- Les NFT comme nouveaux objets de valeur digitale
- Ce que les crypto‑actifs disent du monde financier
Dans l’univers en constante évolution de la blockchain, les crypto‑actifs ne forment pas un bloc homogène. Ils se déclinent en plusieurs catégories selon leur usage, leur conception technique et leur rôle économique. À mesure que l’écosystème s’élargit, il devient essentiel de distinguer ces grandes familles pour mieux comprendre leurs fonctions et leurs logiques internes.
Cet article propose une lecture claire et structurée des principaux types de crypto‑monnaies aujourd’hui en circulation, en expliquant leurs finalités, leurs cas d’usage et les exemples les plus représentatifs.
Les cryptos de paiement comme alternative aux devises
Le Bitcoin, lancé en 2009, reste la première crypto‑monnaie de l’histoire et l’exemple le plus emblématique des cryptos de paiement. Pensé comme une réponse directe aux limites du système financier traditionnel, il a été conçu pour permettre des transactions de pair à pair, sans intermédiaire bancaire, dans un réseau sécurisé et décentralisé.
Son usage initial : servir de monnaie numérique mondiale, résistante à la censure et aux manipulations. Quinze ans après sa création, Bitcoin est accepté par des milliers de commerçants dans le monde, utilisé pour les transferts d’argent internationaux, et considéré par certains comme une réserve de valeur.
Selon Triple A (rapport 2024), plus de 219 millions de personnes dans le monde détiennent du Bitcoin, en hausse de 35 % en un an. Dans certains pays en crise, comme le Liban ou l’Argentine, il sert à préserver le pouvoir d’achat face à l’inflation. Au Salvador, il a même été reconnu comme monnaie légale en 2021, bien que son usage reste encore limité au quotidien.
Bitcoin s’appuie sur un protocole transparent, public, et vérifié collectivement. Ses transactions sont enregistrées dans une blockchain, un registre partagé sécurisé. Son ambition n’est pas de remplacer complètement l’argent traditionnel, mais d’offrir une alternative libre, indépendante, et accessible à l’échelle mondiale. D’autres cryptos partagent cette vocation : Litecoin (LTC), connu pour sa rapidité de traitement, ou Dash, qui propose des paiements instantanés à faible coût, notamment en Amérique latine.
Les cryptos utilitaires pour soutenir l’infrastructure blockchain
Contrairement aux cryptos de paiement, les cryptos utilitaires ne sont pas conçues pour être échangées comme de l’argent. Leur fonction est d’alimenter un réseau ou un protocole en assurant son bon fonctionnement. Chaque transaction, action ou opération sur une blockchain a besoin de ces tokens pour être validée.
L’exemple le plus connu est celui d’Ethereum, deuxième crypto‑monnaie mondiale par sa capitalisation. Son token, l’ether (ETH), est utilisé pour payer les frais de transaction et faire fonctionner les contrats intelligents. Il est indispensable pour interagir avec les milliers d’applications décentralisées (dApps) qui tournent sur Ethereum, dans des domaines aussi variés que la finance, les jeux ou la culture numérique.
D’autres blockchains ont leur propre token utilitaire : Solana (SOL) se distingue par sa rapidité, tandis que Polygon (MATIC) sert à réduire les coûts de transaction en agissant comme une extension du réseau Ethereum. Ces cryptos sont en quelque sorte le carburant des blockchains, sans lequel aucune action ne serait possible.
Selon une étude de CoinGecko (juin 2024), plus de 85 % des projets actifs sur la blockchain utilisent un utility token natif pour réguler leur fonctionnement interne. Ce type de crypto, bien qu’invisible pour le grand public, est au cœur de l’infrastructure du Web3.
Les stablecoins à l’interface entre crypto et monnaie fiat
Dans un univers marqué par la volatilité, les stablecoins offrent une forme de stabilité bienvenue. Ce sont des crypto‑actifs dont la valeur est indexée sur une devise traditionnelle, le plus souvent le dollar américain. Ils sont conçus pour conserver une parité quasi constante, afin de faciliter les échanges et rassurer les utilisateurs.
Parmi les plus utilisés, on trouve Tether (USDT) et USD Coin (USDC), tous deux adossés à des réserves en dollars. DAI, quant à lui, fonctionne différemment : il est garanti par d’autres crypto‑actifs, comme l’ether, selon un mécanisme décentralisé. Ces actifs numériques jouent un rôle crucial dans l’écosystème : ils permettent de stocker de la valeur, d’effectuer des paiements stables ou de participer à des services financiers sans conversion permanente vers une monnaie fiat.
Leur présence est désormais massive sur les marchés. Selon le FMI (février 2024), plus de 70 % des échanges sur les plateformes centralisées impliquent un stablecoin. Cette omniprésence s’explique par leur double fonction : instrument de transaction rapide et réserve de valeur temporaire.
L’intérêt est particulièrement visible dans les usages quotidiens. Payer un café avec une crypto volatile comme le Bitcoin ou Solana pourrait entraîner un changement de prix significatif en quelques minutes. Avec un stablecoin indexé sur le dollar, le prix reste fixe et prévisible, comme avec une carte bancaire. C’est cette stabilité qui en fait un outil adapté à l’échange courant.
Pour approfondir le fonctionnement des stablecoins, leur diversité et leurs enjeux réglementaires, un article complet leur est dédié.
Les cryptos de gouvernance comme outil de décision collective
Certains tokens donnent plus qu’un simple accès technique à un réseau : ils permettent à leurs détenteurs de participer aux décisions qui orientent le développement d’un projet. Ce sont les cryptos de gouvernance, conçues pour faire vivre la logique décentralisée au-delà du code.
Lorsqu’un utilisateur possède un token comme UNI (Uniswap), AAVE (Aave) ou MKR (Maker), il peut voter sur des propositions liées à la gestion du protocole : évolution du code, taux d’intérêt, intégration de nouveaux actifs, budget communautaire. Chaque vote compte selon la quantité de tokens détenus, à la manière d’une participation actionnariale.
Ces dispositifs ont déjà une influence concrète. Chez MakerDAO, les détenteurs de MKR peuvent voter pour ajouter de nouveaux collatéraux à DAI, ou modifier les paramètres de stabilité. Chez Uniswap, des décisions majeures comme l’attribution de subventions ou la gestion des frais passent par un vote collectif. Ces mécanismes permettent d’impliquer les utilisateurs dans le pilotage stratégique, sans entité centrale de contrôle.
Les tokens de gouvernance sont les fondations de la démocratie on‑chain .
Hayden Adams – fondateur d’Uniswap
Les cryptos de gouvernance incarnent ainsi une nouvelle forme de gouvernance numérique, souvent qualifiée de DAO (Decentralized Autonomous Organization). Ils réinventent la participation démocratique, non pas dans une logique étatique, mais dans celle d’un logiciel vivant, modulable par sa propre communauté.
Les memecoins comme phénomènes communautaires
À la frontière entre la culture Internet et l’univers financier, les memecoins sont des crypto‑actifs inspirés de blagues, d’images virales ou de clins d’œil numériques. Ils reposent davantage sur l’adhésion collective que sur une utilité concrète. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ou plus récemment PEPE en sont les exemples les plus connus.
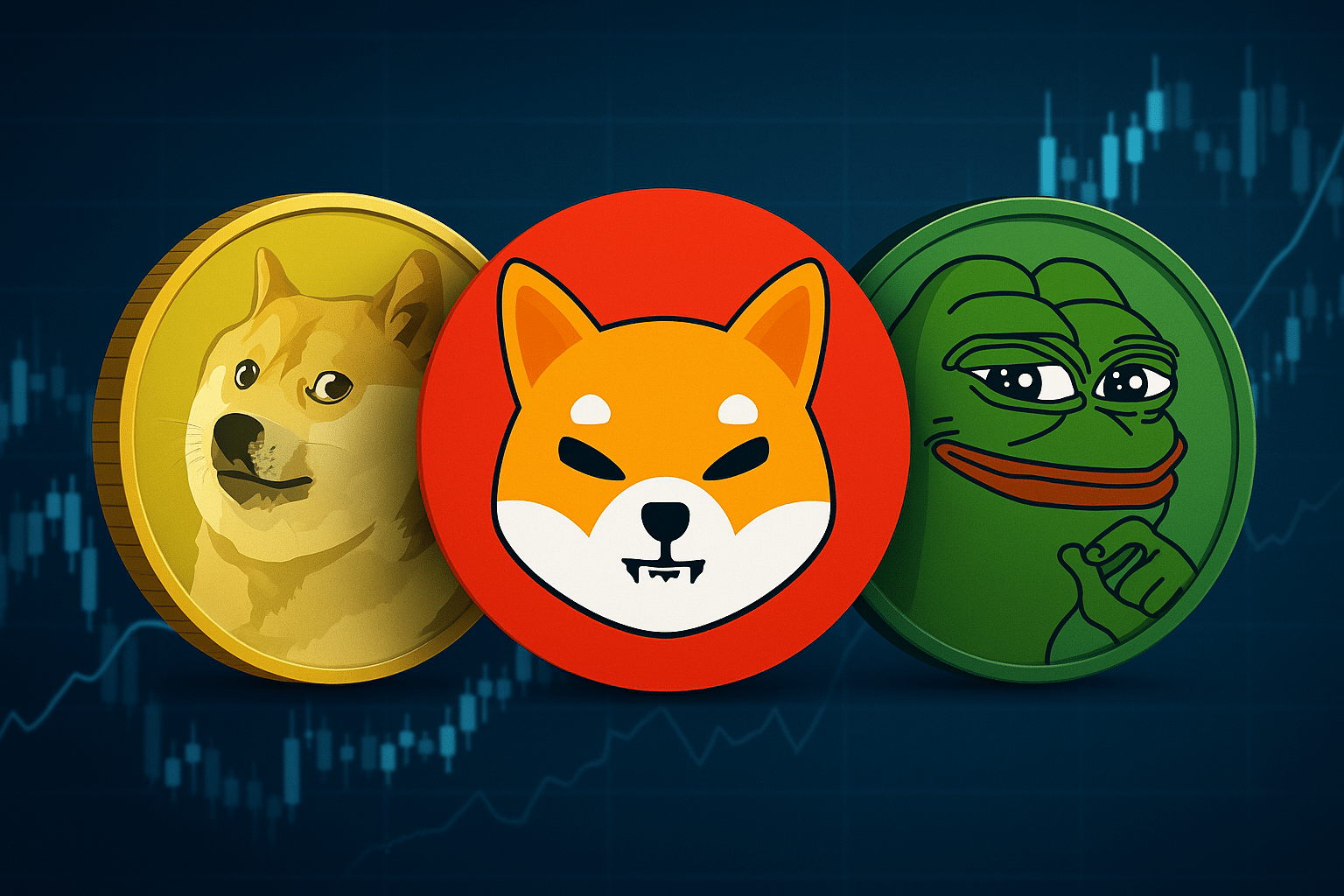
Leur fonctionnement est souvent simple, leur image délibérément décalée. Pourtant, ils peuvent susciter un engouement massif, porté par les réseaux sociaux, les influenceurs ou des figures comme Elon Musk. En avril 2021, Dogecoin représentait jusqu’à 8 % de la capitalisation du marché crypto selon CoinGecko, avant de chuter de plus de 80 % en quelques mois.
Ce type de token illustre les logiques de viralité propres à Internet : un tweet, un forum ou une tendance TikTok peut suffire à déclencher une flambée spéculative. Mais l’absence de fondamentaux techniques ou économiques solides rend ces actifs extrêmement instables.
Les memecoins divisent : certains y voient une porte d’entrée ludique vers l’univers crypto, d’autres un symptôme d’exubérance irrationnelle. Leur succès révèle cependant une vérité durable : la dimension communautaire joue un rôle clé dans la valeur perçue d’un actif numérique.
Les tokens de sécurité comme version numérique des titres financiers
Certains crypto‑actifs ne cherchent pas à innover par leur usage, mais par leur support technologique. C’est le cas des tokens de sécurité, aussi appelés security tokens, qui représentent des actifs financiers traditionnels sous forme numérique : actions, obligations ou parts dans un bien immobilier, par exemple.
Ils obéissent à des régulations strictes, car ils sont assimilés à des titres financiers. En Europe, le règlement DLT Pilot autorise depuis 2023 l’expérimentation d’infrastructures de marché basées sur la blockchain. Ces tokens ne circulent pas librement comme un Bitcoin : leur émission, leur détention et leur transfert doivent respecter les règles de conformité habituelles.
Leur promesse est forte : réduire les coûts, automatiser les procédures de règlement‑livraison, et ouvrir l’accès à des actifs habituellement réservés aux institutionnels. Un exemple concret : en 2018, Elevated Returns a lancé le token « Aspen Coin » représentant 18 % de propriété de l’hôtel St Regis à Aspen via la blockchain Ethereum. Cela a permis à des investisseurs de devenir copropriétaires, de toucher des revenus locatifs et de revendre leurs parts facilement.
Si leur adoption reste encore limitée, les tokens de sécurité incarnent une voie prometteuse pour rapprocher l’innovation blockchain de la finance régulée. Ils ne cherchent pas à remplacer la finance traditionnelle, mais à en améliorer la transparence, l’efficacité et l’accessibilité.
Les NFT comme nouveaux objets de valeur digitale
Parmi les crypto‑actifs, les NFT (pour jetons non fongibles), occupent une place à part. Contrairement aux autres tokens, ils ne sont ni interchangeables, ni divisibles : chaque NFT est unique et traçable. Ils permettent de certifier la propriété d’un objet numérique, qu’il s’agisse d’une image, d’un fichier audio, d’une vidéo ou d’un élément de jeu.
Leur essor a été spectaculaire. En 2021, les ventes de NFT ont atteint 17 milliards $ sur Ethereum et 25 milliards $ toutes chaînes confondues, selon Reuters (décembre 2021). Des collections comme Bored Ape Yacht Club ou Cryptopunks se sont échangées pour des sommes record, suscitant un engouement planétaire.

Mais la flambée initiale s’est essoufflée. À partir de 2022, le marché a connu une forte correction : baisse des volumes de plus de 90 %, chute des prix planchers de près de 80 % pour les collections majeures. En 2025, les volumes mensuels restaient bien loin des sommets (par exemple autour de 430 M $ en mai, contre près d’1 Mrd $ en 2021). De nombreux observateurs estiment aujourd’hui que l’ancienne « hype » est revenue à un niveau faible, voire que « le phénomène est mort » pour certains.
Cependant, la tendance pourrait s’inverser : certains segments, comme les NFT adossés à des actifs réels (RWA) ou ceux liés aux jeux vidéo, montrent des signes de reprise. Les market‑places comme Immutable ou DappRadar affichent une augmentation du nombre d’acheteurs uniques (+50 % en mai 2025). Les NFT ne sont pas morts, mais leur modèle évolue vers des usages plus solides et durables.
Ils incarnent ainsi une nouvelle forme de rareté numérique, où l’appropriation et le service priment sur la spéculation. L’intérêt se concentre désormais sur les applications concrètes et la création de valeur réelle, plutôt que sur la perspective de gains rapides.
Ce que les crypto‑actifs disent du monde financier
Les crypto‑actifs ont beaucoup évolué. Ils ne se limitent plus à quelques projets techniques ou à des effets de mode passagers. Ils forment un ensemble d’outils concrets, utilisés dans des domaines variés, portés par des communautés, des entreprises et des logiques souvent très différentes.
Il ne s’agit pas d’adhérer ou de rejeter, mais de comprendre. Prendre le temps d’observer ce qui se construit, ce qui fonctionne, ce qui cherche encore sa place. Car même si ces technologies ne remplacent pas le système actuel, elles en disent long sur ses limites, ses possibles évolutions, et les attentes nouvelles qu’elles font émerger.
Se familiariser avec ces nouveaux usages, sans idéaliser ni diaboliser, c’est déjà mieux comprendre le monde financier qui se transforme autour de nous.

